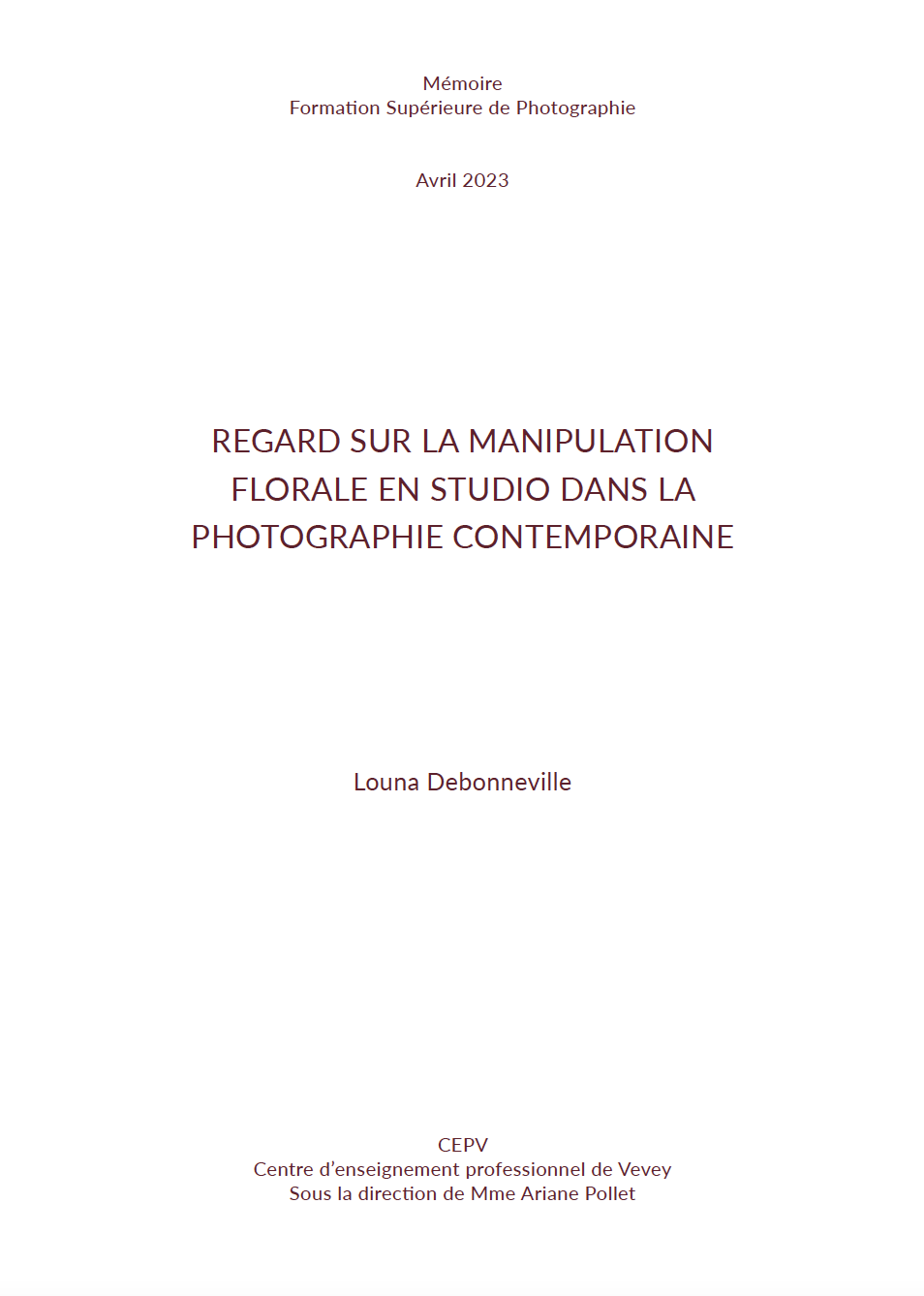Regard sur la manipulation florale en studio dans la photographie contemporaine
2022
Les fleurs sont un témoin de notre société, de problématiques actuelles concrètes. Son évolution rend compte de l’époque, sa place dans notre quotidien évolue. Leurs symboliques sont utilisés pour envoyer des messages puissants, particulièrement dans la photographie. Notamment dans le domaine de la nature morte en studio. La manipulation artistique des fleurs est un sujet récurrent qui traverse l’histoire de l’art et continue d’être présent dans les oeuvres contemporaines occidentales. Le floral, souvent associé à l’éphémère, aux cycles de la vie, à la beauté et la fagilité, inspire à la création. Mais pourquoi l’utilisation des fleurs, en particullier, leur manipulation fascine-elle tant dans la photographie ? Cette tendance peut être causée par un développement trop rapide de notre société : « la nature, parce qu’elle est en voie de destruction, devient objet de contemplation et source d’inspiration pour la sensibilité romantique.»1. Une façon de se rapprocher de cette nature en perdition... Roberto Greco utlise, dans sa démarche quasi picturale, des fleurs, pour la plus part coupée, pour établir une réflexion sur la condition humaine et la beauté cachée. Il met en avant l’enveloppe organique, et ce qui s’en dégage, ainsi que le développement de sa forme et de son odeur au cours du temps et des événements. L’artiste utilise les fleurs ainsi comme allégorie du corps. Cette façon de lier humain et nature est une tentative peut-être de rappeler que nous faisons tous parti de ce monde fragile.
Les démarches artistiques explorées par la suite questionnent les limites de la maîtrise des fleurs, éléments naturels, dans l’environnement artificiel qu’est le studio.
1. Jack Goody, La Culture des fleurs, Paris, Seuil, 1994, page 16
Les démarches artistiques explorées par la suite questionnent les limites de la maîtrise des fleurs, éléments naturels, dans l’environnement artificiel qu’est le studio.
1. Jack Goody, La Culture des fleurs, Paris, Seuil, 1994, page 16